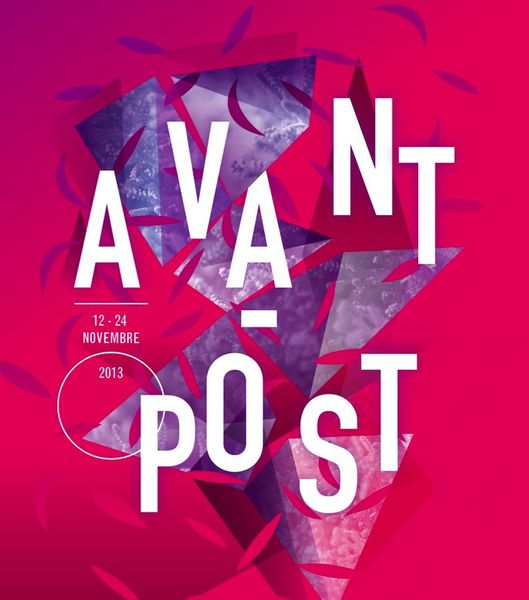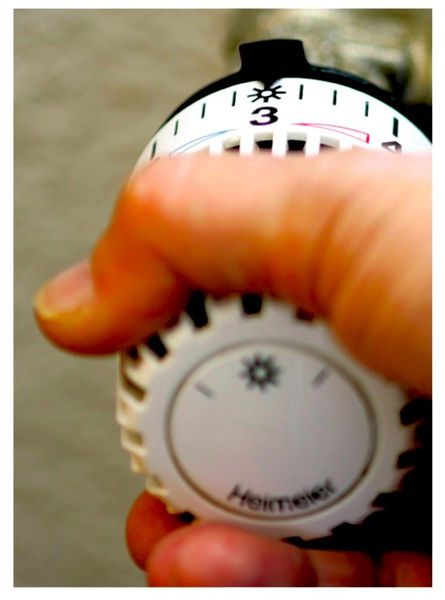![rives de Saône8]() 8 séquences pour un
river-movie sur les rives de Saône
8 séquences pour un
river-movie sur les rives de Saône
En février 2011, le blog avait publié le projet du Grand Lyon concernant une première phase sur la
création de 25 km de promenade depuis la Confluence jusqu’à l’île Barbe. Au total 50 km de rives transformées et
décomposés en différentes séquences d’aménagement intégrant chacune des interventions artistiques.
Le projet des Rives de Saône déroulera son River Movie sur 50 km, soit 25 kilomètres sur chacune des rives : 11 km de la Confluence à l’île Barbe et 4 km dans le Val de Saône, conduisant le
promeneur sur 14 communes et 5 arrondissements de Lyon. L’objectif est bien de préserver l’environnement et de conforter la biodiversité, en étirant la végétation des secteurs naturels, dont le
Val de Saône, jusqu’au cœur de l’agglomération afin de réintroduire la nature en ville.
8 premières séquences sont aujourd’hui menées de concert par les aménageurs, paysagistes, architectes, artistes... pour être livrées dans la même temporalité et pour conserver la cohérence
globale du projet directeur.
D’autres territoires seront d’ores et déjà identifiés pour poursuivre ce mouvement de réappropriation des Rives de Saône dans les prochaines années.
![Rives de Saône]()
Dès 2016, d’autres sites prolongeront le scénario actuel : le quai de l’industrie à Vaise (9e arrondissement de Lyon), la loupe d’Albigny sur Saône-Couzon au Mont d’Or, les marches de
Neuville-sur-Saône, ou encore le nouveau parking Saint Antoine et les terrasses de la Presqu’île à Lyon 1er et 2e
arrondissement.
Cet aménagement urbain suit la logique du Grand Lyon qui s’inscrit dans la démarche de reconquête des fleuves matérialisée par l’aménagement des Berges du Rhône. Cette coulée piétonne finalisée
en 2007 a relié, sur la rive gauche, le parc de la Tête d’or au parc de Gerland sur six kilomètres.
La volonté de renouer avec son environnement fluvial a permis au Grand Lyon d’initier cette démarche de l’autre côté de la presqu’île, le long de la Saône. Un fleuve ombrageux par rapport au
Rhône et de révéler l’âme de la rivière à travers une relation intime et douce. Une grande richesse de liens avec la rivière, tissés à travers plusieurs lignes directrices en suivant le cours de
l’eau. D’abord valoriser les sites naturels et leur biodiversité, tout en préservant un patrimoine écologique exceptionnel. D’où le rôle du projet comme révélateur des usages de la rivière et de
ses rives : pêche à la ligne, aviron, haltes fluviales, promenade.
Recouvrer le paradis à travers huit séquences de couples concepteurs urbanistes, architectes et paysagistes et treize artistes, unis dès l’origine du projet dans un dialogue constant. Selon
Gérard Collomb, « C’est pour être dans la plus grande adéquation possible aux sites que je voulais que les couples concepteurs et artistes soient choisis ensemble dès le début et s’imprègnent
des lieux. Il ne s’agit en aucun cas de plaquer ici ou là une œuvre mais d’une vraie insertion dans un cadre. »
Ensemble, architectes, paysagistes et artistes révéleront la rivière. Au fil des aménagements et des œuvres, ils réaliseront une promenade alliant patrimoine naturel, historique et culturel,
mettant en valeur et développant les usages liés à la Saône et à ses rives: promenade à pied ou à vélo sur les quais, immersion dans la nature. Le cheminement minéral continu permettra une
identification pour le promeneur mais surtout la protection des espaces naturels limitrophes. Les équipes choisies re-végétaliseront les rives dont certaines parties sont inexistantes ou très
minérales en créant un cordon végétal, des parcs et des jardins aquatiques, des prairies, des plages aux endroits les plus larges.
Élaborés en concertation avec les divers maîtres d’œuvre et paysagistes, et pensés en relation avec l’histoire, la poésie et la typologie de chaque site, les projets d’art public retenus dans le
cadre de la première tranche d’aménagement des Rives de Saône rythmeront le parcours au fil de l’eau et les 8 séquences identifiées. Placée en des points stratégiques, chaque réalisation
introduira de la surprise au détour d’un escalier, d’un pont, d’un chemin, afin de convier le promeneur à des expériences sensorielles et intellectuelles, aussi diverses que l’est la création
contemporaine sous toutes ses formes.
Un fil rouge artistique a été confié à Tadashi Kawamata, fin connaisseur des sites aquatiques sur lesquels il a souvent travaillé : grâce à sa présence récurrente, il crée un lien, une trame
narrative, entre les différents sites selon l’approche directrice qu’il a lui-même défini « Marcher, Toucher, Voir ».
UN FIL ROUGE CONFIE À TADASHI KAWAMATA
L’artiste japonais Tadashi Kawamata déroulera un fil rouge artistique avec trois dominantes sensorielles disséminées tout au long du parcours :
• Walk (Marcher) : des liaisons en pente douce destinées à la marche. • Touch (Toucher) : des éléments (comme des plages, des pontons) où le promeneur
pourra se reposer.
• View (Voir) : des points de vue réels ou imaginaires sous la forme d’une tourelle, d’un belvédère ou d’une cabane.
8 SÉQUENCES POUR UN RIVER-MOVIE SUR LA SAONE
D’ici 2013, 15 km de promenade piétonne continue au plus près de l’eau seront aménagés entre la Confluence et l’Île Barbe et entre Fontaines-sur-Saône et Rochetaillée.
Cette première phase du projet Rives de Saône concerne 22 hectares d'aménagement sur huit sites.
Sur chacun d'eux, une équipe de maîtrise d'œuvre différente et un ou plusieurs artistes associés ont imaginé la transformation de leur séquence en respectant un vocabulaire commun aux Rives de
Saône, garant d'une cohérence globale : composition du cheminement continu, choix des matériaux, éclairage, palette végétale, etc.
Ces 8 séquences traversent des paysages très différents : on passe ainsi de Rives de Saône contemporaines à la Confluence à des Rives de Saône plus urbaines longeant le centre- historique de
Lyon. La transition paysagère se fait petit à petit à Caluire à la sortie de Lyon, avec une séquence plus naturelle, un chemin nature, prémice des rives plus bucoliques et plus sauvages à
découvrir de Fontaines-sur-Saône à Rochetaillée.
LES RIVES DE SAÔNE URBAINES (4 séquences)
►► SÉQUENCE 1 : L’ESPACE KITCHENER-MARCHAND ET BAS-PORT RAMBAUD (LYON)
![Rives de Saône Séquence 1]()
Mandataire – ADR Architectes - Georges et Julien Descombes Equipe : SOGREAH CONSULTANTS, BET Structure / ACOGEC, BET Structure / CAP VERT INFRA, BET VRD et infrastructure /LEA, éclairagiste.
Maîtrise d’ouvrage déléguée : SPLA Lyon Confluence Artiste : sélection en cours
Gagné sur la Saône et le Rhône, occupé pendant 40 ans par le marché d’intérêt national, le quartier de la Confluence, longtemps délaissé et séparé de la presqu’île historique par un vaste réseau
routier et ferroviaire, fait l’objet d’un ambitieux projet urbain depuis une dizaine d’années. Ce nouveau quartier en plein essor accueille désormais le nouvel Hôtel de Région, des immeubles de
bureaux et d’habitations dessinés par des architectes de renoms, un vaste pôle de loisirs et de commerces, des lieux de culture et de création, de nouveaux espaces publics...
Sur un 1,2 kilomètre, le site du bas-port Rambaud/Espace Kitchener-Marchand comprend trois séquences :
- au sud, le théâtre de verdure et le parc de Saône,
- au centre, le nouveau quartier de vie et les maisons flottantes,
- au nord, un territoire marqué par la présence de trois ouvrages d’art : le viaduc de la Quarantaine (voie ferrée aboutissant à la gare de Perrache), le viaduc de l’A6 (par lequel l’autoroute
débouche du tunnel de Fourvière, avant de s’engouffrer dans la vallée du Rhône) et le pont routier Kitchener Marchand. Ce triple axe de circulation reflète un urbanisme complexe (l’alliance de la
gare multimodale de Perrache et de l’échangeur autoroutier), qui scinde la presqu’île en deux parties.
Associé à l’équipe artistique, le projet des architectes Georges et Julien Descombes en lien avec la SPLA Lyon Confluence, a pour ambition d’assurer la continuité du cheminement piéton,
d’imaginer une liaison attractive entre la nouvelle polarité du quartier de la Confluence et la presqu’île (en particulier sous la voûte ingrate formée par la succession des trois ponts), ainsi
que diverses manières d’instaurer de la convivialité autour de l’eau, compatibles avec les usages actuels et à venir (bateaux d’habitation, restaurants, loisirs, détente et navigation).
Leur projet s’inspire de l’histoire de la Saône, de ses usages actuels et des pratiques plus anciennes qui faisaient de la rivière un support de l’activité économique. Il prévoit ainsi, au fil de
l’eau, des ambiances distinctes :
- dans le secteur des ponts et du port, la voûte formée par la succession des ponts sera adoucie et le niveau du quai historique sera retrouvé au plus près de l’eau. L’étroitesse du quai sous les
ponts sera compensée par une estacade. C’est sur cette partie spécifique que va intervenir l’équipe artiste associée sélectionnée ;
- Plus loin, le théâtre de verdure sera valorisé (renouvellement végétal en quai haut, nouveau mobilier urbain) ;
- enfin, les alentours de la station service du port Rambaud deviendront une halte fluviale disposant d’une passerelle qui reliera le jardin aquatique naturel au parc de Saône.
![Rives de Saône Séquence 1-1]()
►►SÉQUENCE 2 : LA PROMENADE DU DÉFILÉ DE LA SAÔNE (LYON)
![Rives de Saône Séquence 2]()
Mandataire : agence HYL - Arnaud Yver et Pascale Hannetel Équipe : Coup d’éclat - Concepteur Lumière ; ISL - BET ouvrage d’art et hydraulique ; SOTREC- BET VRD ; Sinbio - BET Génie Végétal ;
Artiste : Tadashi Kawamata
Le site du Défilé de la Saône dessine sur 2,9 km, rive gauche, une ample courbe, portion de la rivière qui constitue une image emblématique, pittoresque et historique de la ville de Lyon : c’est
en effet ici que la cité s’est d’abord développée.
La promenade du Défilé de la Saône longe un environnement d’une grande richesse patrimoniale où se rencontrent l’histoire et la géographie de la ville, de l’ancien port d’Occident aux anciens
greniers d’abondance qui accueillent aujourd’hui la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Elle fait ainsi face à la partie la plus ancienne de la cité, le Vieux Lyon, surplombé par la
colline de Fourvière et longe son cœur historique, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Outre les façades Renaissance du Vieux-Lyon, le parcours offre un beau point de vue sur un grand nombre de bâtiments historiques, notamment la primatiale de Saint-Jean, l’ancien Palais de
justice, mais aussi la basilique de Fourvière, tandis que rive gauche, il longe le quai Saint-Antoine et son marché quotidien (2ème marché lyonnais). Plus
loin on s’engage sur le quai Saint-Vincent, puis le quai Gillet, jusqu’au bâtiment des Subsistances qui furent autrefois un couvent puis une caserne militaire, et qui abritent aujourd’hui l’École
des Beaux-arts.
Le site du Défilé de la Saône, au cheminement heurté par des rampes et des escaliers, constitue un terrain d’expérimentation idéal pour la collaboration entre artistes et maîtres d’œuvre.
Mené par l’agence HYL (Arnaud Yver / architecte), ISL, Sotrec, Sinbio et Coup d’éclat, le projet de Promenade du Défilé de la Saône consiste à aménager un nouveau cheminement continu sur près de
2.9 kilomètres au plus près de l’eau.
Le nouveau parcours sera rendu possible par la création d’estacades - de 3.5m de large - sur 1.9 kilomètre.
Cette promenade sera l’occasion d’offrir aux Lyonnais, Grand Lyonnais et visiteurs un point de vue inédit sur le cœur de l’agglomération, et surtout de retrouver la rivière. Les quais
comprendront des jardins et alcôves, continuité du fil vert créé quai Gillet, qui inviteront à la flânerie et à la détente, mais aussi à une échappée culturelle vers la mémoire patrimoniale de la
ville.
« Flâner entre terre et eau »
![Rives de Saône Séquence 2-1]()
Sur le site de la Promenade du Défilé, Tadashi Kawamata a choisi d’intervenir sur la promenade en la ponctuant de trois évènements, qui conserveraient à la fois un cheminement bas et
permettraient des liaisons avec le quai supérieur, et qui sont aussi le point de départ du fil rouge artistique.
Célèbre pour ses constructions en milieu urbain et naturel, réalisées en bois, fragments assemblés les uns aux autres pour bâtir des monuments éphémères ou pérennes et pour son intelligence
simple, sa manière subtile d’investir les territoires pour y créer des espaces de surprise et de beauté, l’artiste a imaginé trois œuvres pour créer
des accroches entre la promenade et les quartiers limitrophes.
En souvenir du Pont d’Ainay, au niveau du quartier du même nom, Le Balcon, un belvédère en bois s’installe sur le dernier vestige de l’ouvrage aujourd’hui disparu. L’artiste intervient tout
d’abord en partie haute, adossant sur la culée de l’ancien pont d’Ainay, un belvédère permettant de jouir à loisir de la vue. Il introduit ainsi du bois dans un paysage à dominante fortement
minérale et remémore l’histoire du site pour inciter à la contemplation et soulever la question de la modification de nos points de vue, de nos perceptions et de notre expérience du site.
La double rampe, accrochée au parking Saint-Antoine, est constituée de deux rampes de 180 mètres de long entrecroisées. Elle assurera la continuité de la promenade au plus près de la Saône et
permettra de gommer temporairement la présence du parking, tout en introduisant une note ludique. Cette œuvre monumentale illustre de façon spectaculaire l’intention de l’artiste d’accompagner le
promeneur ou l’usager du parking dans des pentes douces, en contraste avec les escaliers qui marquent fortement le reste du paysage, pour cheminer dans le lit de la rivière.
Enfin, dans les méandres du Défilé, au bas-port Neuville au pied de la passerelle de l’homme de la Roche, l’artiste propose Les planches. Une rampe
fine monte vers la pile du pont et une plage sous forme de planches larges à fleur d’eau invitera les promeneurs à profiter de l’ensoleillement d’un site exposé plein sud et de sa situation un
peu en retrait de la ville, pourtant si proche.
![Rives de Saône Séquence 2-2]()
« Le balcon »
Structure en pin Douglas et platelage en châtaigner ou robinier. Garde corps en acier galvanisé. Largeur : 9,32 mètres. Profondeur : 3 mètres à partir du mur du quai.
Surface : 30 m2. Capacité d’accueil : jusqu’à 80/90 personnes.
« La double rampe »
Structure en Pin Douglas et platelage et habillage en châtaigner, robinier ou chêne. Garde-corps et main courante : acier galvanisé. Longueur : 180 mètres. Largeur des rampes : de 1,80 mètre à
3,80 mètres.
Surface : 900 m2. Pente maximum : 4% (faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite). Capacité d’accueil : Jusqu’à 1 000 personnes.
« Les planches »
Structure métallique de caisson métallique recouvert d’un platelage bois (châtaigner ou robinier), avec rives métalliques et éventuel habillage bois. Pare-embâcle : tubes acier avec habillage
bois. 6 planches de taille maximum : 14 (L) x 3 (l) x 0,30 (ep) / 5 planches horizontales et 1 en pente. Surface : 42 m2 - Capacité d’accueil : 20 personnes environ.
Mode d’accrochage : Ancrage sur des pieux métalliques dans l’eau et au dessus du bas-port (revêtus d’un coffrage en bois) 14 pieux au total.
![Rives de Saône Séquence 2-3]()
►►SÉQUENCE 3 : LE DÉBOUCHÉ DE LA PASSERELLE DU PALAIS DE JUSTICE (LYON)
![Rives de Saône Séquence 3]()
Mandataire : Dumetier Design – Charlotte Vergely Équipe : Alep Architectes ; LEA - Concepteur lumière ; ICC - BET VRD. Artistes : Michael Elmgreen & Ingar Dragset
Cette séquence, sur un peu plus de 500 mètres est la seule de la rive droite réalisée dans la première tranche du projet Rives de Saône.
Elle s’étend du pont Bonaparte aux bretelles du pont Maréchal-Juin, où plusieurs édifices historiques se succèdent en front de quai : le chevet de la primatiale Saint-Jean, le Palais Saint-Jean
et l’ancien Palais de justice, construit par Baltard en 1850.
La passerelle, construite en 1983 est suspendue par des haubans plantés dans un mât unique ancré sur la rive gauche de la Saône. Elle enjambe la rivière depuis le quai Saint- Antoine, sur la
presqu’île, pour déboucher devant le Palais de Justice.
Reliant les quartiers de Saint-Jean et de la presqu’île, cette séquence franchit littéralement la Saône. Le projet des artistes et des architectes se propose de « resculpter » un site marqué par
l’ordre, le classicisme et la verticalité, qu’accentuent les colonnes de l’ancien Palais de Justice, dont la façade sera mise en valeur.
Le groupement Dumetier design, Alep architectes, ICC et LEA aura pour tâche, à travers l’aménagement du débouché de la passerelle, d’améliorer les liaisons piétonnes entre le quartier du Vieux
Lyon et la presqu’île, aujourd’hui entravées par la dense circulation du quai Romain Rolland. Le Palais de justice rénové sera mis en valeur par la création d’un parvis, tandis qu’un belvédère
s’élancera pour donner à voir la Saône et la presqu’île.
Deux larges bassins seront aménagés de part et d’autre de l’escalier du Palais de justice qui en reflèteront la silhouette et assiéront la stature. Le mouvement de l’eau contribuera à adoucir la
minéralité du site.
De chaque côté du belvédère accueillant l’œuvre, des alignements de buis proposent une présence végétale. La mise en lumière joue un rôle singulier : l’éclairage est totalement intégré au
traitement architectural de manière à rendre l’ambiance nocturne plus agréable.
« Bousculer l’ordre »
![Rives de Saône Séquence 3-1]()
Sur le belvédère, au débouché de la passerelle, s’élèvera une étonnante sculpture de 2.7m de haut, The Weight of One Self (le Poids de soi-même). Elle est l’œuvre du duo d’artistes scandinaves
Michael Elmgreen et Ingar Dragset.
Austère et solennel, le Palais de Justice de Lyon traduit dans son architecture les valeurs d’ordre, de fermeté et d’équité dont il est le garant. Dans son axe, enjambant la Saône, la passerelle,
soutenue par un pylône et des haubans métalliques, respecte la symétrie classique de l’ensemble. A sa droite, au bord de l’eau, une statue d’allure classique viendra, tel un grain de sable dans
les rouages, introduire une onde de trouble, de perplexité.
L’homme porte son double, devenant ainsi son propre sauveur mais aussi son propre fardeau. Ces préoccupations philosophiques font écho aux questions de responsabilités civiques et individuelles
débattues quotidiennement au Palais au Justice. L’œuvre reprend la longue tradition classique de la sculpture : le nu héroïque et le marbre, même si il s’agit ici d’une technique nouvelle (la
poudre de marbre solidifiée).
Un « néo-classicisme » en clin d’oeil à l’architecture des lieux. Par leur échelle, supérieure à l’échelle humaine, les deux personnages font également fonction de repère dans le paysage.
Œuvre de Michael Elmgreen et Ingar Dragset
« The weight of Oneself »
Poudre de marbre reconstituée. Traitement de surface anti graffitis. Socle acier corten. Hauteur : 2,70 mètres.
700 kg environ. Le socle s’inspire de la structure des ducs d’Albe. Éclairage uniforme de la sculpture avec 6 sources différentes.
![Rives de Saône Séquence 3-2]()
►► SÉQUENCE 4 : LE BAS-PORT GILLET (LYON)
![Rives de Saône Séquence 4]()
Mandataire : ILEX - Jean Claude Durual – Noémie Chevereau Équipe : Marc Speeg - Concepteur Lumière ; Biotec - BET génie Végétal ; Cap Vert - BET VRD ; AGIBAT - BET ouvrage d’art ; ANTEA - BET
hydraulique. Artistes : Pablo Reinoso, Meschac Gaba.
Le parcours de 1,9 km débute rive gauche au pied du Grenier d’abondance (ancien grenier à céréales du 18ème siècle, qui accueille aujourd’hui les bureaux de
la Drac). Au- dessus, trône l’imposant fort Saint-Jean, bâti aux alentours de 1830 sur le rocher de l’Aigle, à l’emplacement des anciennes murailles de la ville. De concert avec le rocher de
Pierre Scize, sur l’autre rive, le Rocher de l’Aigle resserre sensiblement le Val de Saône et constitue une frontière naturelle.
Le bas-port Gillet constitue une réelle transition entre l’agitation de la ville et un paysage plus vert et bucolique s’étageant sur les collines qui glissent vers la Saône.
Le promeneur pénètre ici dans la ville par un quartier calme et résidentiel. La balme surplombe la rive, comme une grande canopée.
Le groupement Ilex, Antea, Biotec, Cap Vert, Agibat, Marc Speeg assurera l’aménagement de cette séquence de transition importante entre la promenade urbaine et la promenade plus naturelle du
chemin nature.
Les bas-ports plus larges permettent une densification de la végétation au fur et à mesure que l’on remonte vers le Nord. L’équipe s’est lancé un double défi : réintroduire de la nature dans
cette partie, et recréer un dialogue entre le quai haut et le bord de Saône, comme une invitation à venir vivre sur le bas-port.
Le cheminement piéton est de 1,9 kilomètre sur cette seule portion. Le groupement en assure la continuité et va introduire de petits salons verts arborés et enherbés, des jardins aquatiques,
voire de vastes prairies quand l’espace le permet. Cette promenade végétale ne va pas donc seulement s’étirer en longueur mais en épaisseur, pour donner de la profondeur de champ a cette
séquence.
Le projet s’articulera avec les grandes opérations structurantes en cours sur le quartier Serin : construction du Pont Schuman entre Vaise et le bas de la colline de la Croix-Rousse, percement du
second tube modes doux du tunnel de la Croix-Rousse, réhabilitation du quai Gillet et de l’avenue de Birmingham. C’est aussi le lieu où se situeront les premières péniches d’habitation qui
devront être repositionnées de part et d’autre du pont Schuman.
« Dessiner avec l’espace »
![Rives de Saône Séquence 4-1]()
Dans ce quartier résidentiel et paisible, le ville et la nature se rejoignent et la balme surplombe la rive comme une grande canopée. Espace de détente, de flânerie où aux beaux jours l’on
retrousse son pantalon pour tremper les pieds dans l’eau, le Bas-Port Gillet laisse place avec les artistes Pablo Reinoso et Meschac Gaba à la fantaisie, au jeu et à l’inattendu.
Sortant des niches situées sous les doubles escaliers menant aux rives, des tiges métalliques souples surgissent et se développent sur une centaine de mètres, courant le long des murs, escaladant
les parois. L’œuvre Nouages de l’artiste argentin Pablo Reinoso évoque le végétal et son principe de croissance inéluctable mais aussi les cordages de bateaux venant s’amarrer le long de la
Saône, ou encore l’utilisation autrefois des quais par les tisserands lyonnais pour teindre, tordre et faire sécher les tissus. Ornement inattendu, l’œuvre de Pablo Reinoso, d’allure organique,
s’articule parfaitement avec la double trame végétale et minérale de l’aménagement du site. Elles offrent une fonction d’assise tout en contribuant à réindroduire le concept de végétation dans un
site jusqu’alors très minéral.
Ces volutes d’inspiration végétale, dont les circonvolutions ne sont pas sans rappeler l’Art nouveau d’Hector Guimard, évoqueront les fils de soie artificielle des usines Gillet et la végétation
qui serpentera bientôt le long du mur. Universel, le jeu de marelles se décline selon différentes formes : rectangulaire, carrée, circulaire, triangulaire ou en spirale. L’artiste béninois
Meschac Gaba s’approprie ce dispositif populaire et installe un parcours d’une dizaine de marelles en différents points du site, du quai haut au bas-port qu’il appelle le jeu de la vie.
Dans chaque case, l’artiste fait figurer un symbole, généralement lié à la faune ou à la flore, et issu d’armoiries du Grand Lyon ou de différents pays francophones. Il s’agit ainsi, pour lui, de
ramener la nature en ville, en cohérence avec le projet global des Rives de Saône.
Détournement, dialogue des cultures, l’artiste Meschac Gaba s’appuie sur les pratiques de loisirs et de plein air sollicitant la participation active des habitants. Associés dans le processus
artistique, des enfants des écoles de la ville ont été invités à redessiner certaines armoiries et à inventer de nouvelles règles de jeu.
Universel, le jeu de marelles se décline selon différentes formes : rectangulaire, carrée, circulaire, triangulaire ou en spirale. L’artiste béninois Meschac Gaba s’approprie ce dispositif
populaire et installe un parcours d’une dizaine de marelles en différents points du site, du quai haut au bas-port qu’il appelle le jeu de la vie.
Dans chaque case, l’artiste fait figurer un symbole, généralement lié à la faune ou à la flore, et issu d’armoiries du Grand Lyon ou de différents pays francophones. Il s’agit ainsi, pour lui, de
ramener la nature en ville, en cohérence avec le projet global des Rives de Saône.
Détournement, dialogue des cultures, l’artiste Meschac Gaba s’appuie sur les pratiques de loisirs et de plein air sollicitant la participation active des habitants. Associés dans le processus
artistique, des enfants des écoles de la ville ont été invités à redessiner certaines armoiries et à inventer de nouvelles règles de jeu.
Œuvre de Meschac Gaba
«Le jeu de lavie»
10 marelles prévues (la 1ère en 2013, les 9 autres en 2014 après la réalisation du Pont Schuman) Armoiries, traits de contours et textes : mosaïque en émaux
de Venise gamme « grand passage » Fond de case : mortier beige Dimensions variables selon les marelles :
Longueur maximum : 4,75 mètres Largeur maximum : 3,64 mètres Dimension des motifs : 40 x 40 cm en moyenne
Œuvre de Pablo Reinoso
« Nouages » Les sculptures sont réalisées en profilés acier de section 6 cm Traitement des surfaces par sablage, métallisation et peinture industrielle epoxy 1 œuvre, 4 sculptures : 2 installées
dans des niches sous escaliers, 2 sur des placettes Grand escalier : 25 mètres environ Petit escalier : 15 mètres environ Placettes : 8 à 9 mètres pour chaque placette Linéaire total d’acier :
750 mètres environ Capacité d’accueil : 20 à 25 personnes Ancrage directement dans la chape de béton de 16 cm d’épaisseur Les éléments verticaux sont également ancrés dans le mur de quai par
chevillage chimique Éclairage des murs et des niches conçus par les MOE
![Rives de Saône Séquence 4-2]()
LA TRANSITION ENTRE VILLE ET NATURE (1 Séquence)
►►SÉQUENCE 5 : LE CHEMIN NATURE (LYON / CALUIRE-ET-CUIRE)
![Rives de Saône Séquence 5]()
Mandataire : BASE - Bertrand Vignal – Marie Thomas. Équipe : ON - Concepteur lumière ; HYDRATEC - BET hydraulique ; DVVD - BET ouvrage d’art ; SOTREC - BET VRD ; Champalbert Expertises - BET
Génie Végétal. Artistes : Érik Samakh, Pascale Marthine Tayou, Tadashi Kawamata.
Du quai Gillet aux chevets de l’Ile Barbe, le site du Chemin nature longe, sur près de deux kilomètres, les villes de Lyon et de Caluire-et-Cuire.
Le Chemin nature est caractérisé par son étroitesse et sa linéarité, mais également par l’alternance de milieux végétaux ouverts et fermés.
Le chemin nature constitue véritablement la jonction entre la Saône urbaine et une Saône plus « sauvage ».
L’équipe prendra soin de développer les accroches aux quartiers de Caluire, notamment au niveau de la place de la Rochette, qui fera l’objet d’une recomposition d’ensemble comprenant la création
d’une placette au bord de l’eau.
Entre les quais Clemenceau et Gillet, c’est une véritable galerie végétale qui sera créée à partir d’espèces adaptées à l’écosystème.
Cette végétalisation efface le caractère oppressant des murs qui deviennent le support de petits jardins miniatures.
L’équipe a fait preuve d’une grande ingéniosité pour installer ce cheminement en respectant les espaces sensibles traversés: aménagement de chemins portés sur pieux ou large estacade permettant
de contourner ces espaces.
Le Chemin nature, en raison de sa linéarité et de son étroitesse, sera propice aux activités comme la marche, la course à pied, la pêche à la ligne. Le contact avec le bord de l’eau est également
recherché. Des estacades et pontons flottants seront créés pour favoriser la pratique de l’aviron et pour permettre aux sportifs et promeneurs de déambuler entre la fraîcheur de la végétation
foisonnante et celle de la rivière.
« s’immerger dans la nature »
![Rives de Saône Séquence 5-1]()
Ici, soudain, la ville s’efface et la nature semble reprendre ses droits. Le long de la rive, en contrebas de l’avenue Clémenceau, on chemine entre les buissons et les arbres au fil de l’eau.
Etroit, le passage s’apparente par moment à un chemin côtier que l’on emprunte en file indienne, chacun absorbé dans ses pensées ou par le rythme de la marche. Tel le Petit Poucet avec ses
cailloux blancs, les artistes Pascale Marthine-Tayou et Erik Samakh ont disséminé sur ce parcours autant d’éléments soulignant la magie des lieux.
L’artiste camerounais Pascale Marthine-Tayou investit la surface du mur qui, côté quai, court le long du chemin telle une barrière infranchissable. En y greffant différentes matières et couleurs,
il transforme cette surface neutre, uniforme en un espace de narration que les différents usagers (promeneurs, joggeurs, flâneurs ou navigateurs) pourront s’approprier à leur guise. Sur ce mur
imposant, une série de masques africains incrustés dans la paroi, faisant parfois office de gargouilles. L’œuvre Au fil de l’eau évoque une tradition inspirée d’Afrique centrale : des
masques-passeports, chatoyants visages stylisés en céramique qui, avant l’arrivée des Européens, jouaient le rôle de papiers d’identité. Le plus grand d’environ deux mètres de haut sera visible
depuis le quai de l’Industrie, en face. Intimiste, discrète, l’intervention se fait plus majestueuse et monumentale là où le site, souvent étroit, s’élargit et le permet. L’œuvre est également
visible depuis l’autre rive, donnant l’impression d’un rideau de matière habillant le mur de quai.
Parallèlement, l’artiste Erik Samakh parsème le chemin nature de Lucioles aquatiques, petites diodes lumineuses incassables et résistantes à l’eau
qui, accumulant de l’énergie solaire le jour, s’allument de manière intermittente dès la tombée de la nuit. Scintillement magique dans l’obscurité, ces clignotements, visibles dans leur ensemble
depuis l’autre rive, évoquent la présence vivante de lucioles et engageront un dialogue poétique avec la voûte étoilée
Sur la berge, Erik Samakh installe encore des Girouettes à crues, blocs de pierre placés sur un axe mobile en inox, pivotant au gré du courant et des
crues de la rivière. Induisant un rapport participatif à l’œuvre, les promeneurs pourront s’amuser à en changer l’orientation et sont invités à s’en servir pour s’asseoir, pique-niquer ou pêcher.
La mise en scène proposée par les paysagistes s’attache à créer des zones de repos, et joue entre ombre et lumière pour valoriser la végétation du site. C’est ici que Tadashi Kawamata déploiera
sa Terrasse, qui s’avancera au-dessus de la promenade et de l’eau. L’artiste souhaite travailler sur les situations de passage, les transitions au cours de la promenade. En contraste avec un
paysage fortement marqué par la présence d’escaliers, il propose des liaisons en pentes douces, au ras de l’eau ou de la berge, comme cette terrasse en balcon et sa rampe d’accès au quai bas.
Œuvre de Pascale Marthine-Tayou
«Au fil de l’eau» 200 à 300 masques de 4 tailles : 4 x 6 cm environ, 0,9 kg 18 x 23 cm environ, 3,5 kg 30 x 50 cm environ, 7 kg 120 x 2 mètres environ (pour un masque), 50 kg maxi Longueur totale
: 120 mètres de mur minimum - Répartition aléatoire voulue par l’artiste, espacement suffisant pour ne pas fournir de prises à l’escalade. Plâtre polyester, fibre de verre et résine polyester /
Vernis de protection Fixation des masques par scellements
Œuvres de Erik Samakh
« Lucioles aquatiques » 150 lucioles Plots lumineux solaires (leds vertes) encastrés dans le mur et se rechargeant avec l’énergie solaire. Composants d’un plot : LED verte, cellules
photovoltaïques, batterie rechargeable Lithium Polymère, carte électronique, coque polycarbonate anti-UV. Dimensions et poids d’une luciole : Diamètre : 84 mm Hauteur : 25 mm Poids : 150 g Mode
d’accrochage : Carottage circulaire dans le mur puis fixation du plot dans un boitier d’encastrement avec une colle-mastic.
« Girouettes à crues » 3 girouettes, regroupées sur un même site Pierres en granit d’aspect brut, axe en acier inoxydable 2 x 1 mètre maximum (environ 2,5 tonnes chacune) Principe structurel :
Tube avec un roulement en partie haute (roulement graissé à vie, pas de maintenance nécessaire), sur lequel est soudée l’armature permettant de fixer la pierre. Fondations : semelles bétons.
Œuvre de Tadashi Kawamata
« La terrasse » Ensemble en bois (pin Douglas, châtaigner, robinier) Environ 20 mètres de long et 4 mètres de large / Surface : environ 80 m2 Débord d’environ 4 mètres au dessus de la berge Rampe
d’accès inclinée à 5% avec un palier Capacité d’accueil : Jusqu’à 240 personnes Mode d’accrochage : Ancrage sur le quai haut (semelle béton) et sur le mur de quai (longrine en béton armé).
L’habillage bois du garde-corps sera réalisé in-situ par l’artiste (aspect irrégulier / aléatoire)
![Rives de Saône Séquence 5-2]()
LES RIVES « NATURELLES » DE LA SAÔNE
►►SÉQUENCE 6 : ANCIENNE ÉCLUSE DE CALUIRE
![Rives de Saône Séquence 6]()
Mandataire : HYL - Arnaud Yver Équipe : Géraud Périole - Concepteur Lumière ; ISL - BET ouvrage d’art et hydraulique ; SOTREC - BET VRD ; Sinbio - BET Génie Végétal Artiste : Jean-Michel Othoniel
Toujours en rive gauche de la Saône, le site de l’ancienne écluse de Caluire-et-Cuire, scindé en deux par le resserrement des balmes de Saint-Rambert et Caluire, déroule un kilomètre de
promenade.
L’ancienne écluse accueille aujourd’hui des activités nautiques, tandis que les maisons éclusières abritent un club d’aviron. Mais surtout, elle voisine avec la verte Ile Barbe (l’île « barbare
»), qui fut à l’époque romaine un refuge pour les druides, puis pour les Chrétiens persécutés.
On y signale dès le 5ème siècle l’établissement d’un monastère. Toutefois, l’âge d’or de cette abbaye bénédictine débute véritablement au 9ème siècle. Elle jouit jusqu’au 14ème siècle d’une certaine puissance et d’une grande indépendance vis-à-vis de l’archevêché
lyonnais. En 1793, elle est morcelée et ses bâtiments sont vendus à des propriétaires particuliers. Reliée aux rives de Caluire et de Saint-Rambert par un pont suspendu datant de 1827, l’île
Barbe est aujourd’hui un site classé, dont les habitants se sont constitués en 1977 en « baronnie souveraine ».
Maîtres d’œuvre et artiste travailleront ici particulièrement sur l’idée d’une forme de conversation visuelle entre le site de l’ancienne écluse de Caluire et la pointe de la médiévale île Barbe,
toute proche.
Le groupement HYL Paysagistes, Géraud Periole, ISL, Sinbio aura pour mission d’assurer la revégétalisation du cheminement piétonnier qui se déroule le long des rives de Saône.
Le parcours se divisera en deux séquences :
- Au niveau de l’ancienne écluse, réhabilitée pour accueillir une nouvelle halte fluviale ainsi qu’une nouvelle péniche commerciale, le projet fait la
part belle aux activités nautiques et notamment aux clubs d’aviron. Les maîtres d’œuvre créeront également des liaisons avec le pont de l’île Barbe, tout en isolant la rive, grâce à un rideau
d’arbres, de la forte circulation du pont.
- Une seconde séquence, plus bucolique et davantage dédiée à la promenade, se déroulera en amont de l’Ile Barbe. Le défi par l’équipe HYL consistera en
grande partie à établir un dialogue visuel avec le site remarquable de l’île.
Il s’agit ici de tisser un lien paysager entre les balmes vertes des contreforts de Cuire et les rives de l’Ile Barbe. Une végétation importante masquera donc l’intervention humaine le long des
murs en béton du quai, mais en préservant quelques rochers débordant du mur.
Ce nouvel espace public sera connecté au quartier de Cuire le Bas par une nouvelle rampe accessible aux personne à mobilité réduire.
« entrer dans la légende »
Outre son caractère propre, l’ancienne écluse de Caluire a l’avantage d’offrir une vue imprenable sur l’île Barbe, surnommée « l’île barbare ». Autrefois, raconte-on, les druides y effectuaient
des sacrifices humains. Un halo de légendes et d’histoires entoure cette île, rocher touffu surgi de l’eau tel un mirage. Rituels collectifs, fêtes et processions s’y sont déroulés au fil des
siècles, érigeant l’île en repère religieux. Le temps semble ici suspendu et un caractère immémorial et mystique enveloppe les lieux.
L’histoire mystérieuse de l’Ile Barbe a inspiré à l’artiste Jean-Michel Othoniel une féérie colorée, fragile et merveilleuse. Tout en perles géantes de verre coloré, vocabulaire plastique qu’il
exploite depuis de nombreuses années, son Belvédère et ses Lanternes sur l’Ile Barbe surprendront les usagers des bords de Saône qui ne s’attendent pas à rencontrer ici, dans un tel cadre naturel
et patrimonial, des objets à l’aspect si fragile. L’artiste Jean-Michel Othoniel s’attache à la magie ambiante, en créant un belvédère d’observation aérien et précieux, situé sur le bajoyer de
l’ancienne écluse, et trois lanternes lumineuses, également réalisées en verre de Murano coloré, sur la pointe de l’Ile Barbe.
« Le Belvédère de Caluire » 6 mâts en acier, habillage de perles de verre et de moulages en fonte d’aluminium. Au bout de chacun des 6 bras, une boule éclairante est suspendue. Garde-corps du
belvédère : grilles en fonte d’aluminium anodisé. Rampe d’accès : tubes et profilés en acier, main courante de section ronde, plancher en bois. Perles de couleurs ambre, cobalt, cristal,
turquoise, rouge et aluminium. Dimensions : 3 mètres de diamètre / Hauteur : 5,10 mètres Socle : cylindre de 2,5 m de hauteur / Rampe : 55 m de
longueur, pente à 4% max (accessible PMR) Capacité d’accueil : 4-5 personnes Ancrage et fondations : Belvédère : Implantation sur un radier d’épaisseur 0,6 mètre et d’une largeur maximale de 1,40
mètre appuyé sur 4 micropieux - Passerelle : une poutre en béton armé supporte les poteaux. Éclairage intégré à l’œuvre.
« Les lanternes de l’Ile Barbe » Serrurerie métallique et perles de verre de Murano. Des LED sont intégrées dans chaque lanterne. Dimensions : Lanterne 1 : 92 (h) x 60 x 60 cm. 72 perles. Poids
total des perles : 92 kg. Lanterne 2 : 108 (h) x 70 x 70 cm. 45 perles. Poids total des perles : 57 kg. Lanterne 3 : 90 (h) x 153,5 cm. 65 perles. Poids total des perles : 70,5 kg. Diamètre des
perles : 8 à 12 cm / Hauteur des mats : 6,50 mètres / Lanternes fixées sur trois mats d’éclairage standard et raccordées au réseau d’éclairage public.
![Rives de Saône Séquence 6-1]()
►►SÉQUENCE 7 : PROMENADE DE FONTAINES-SUR-SAÔNE
![Rives de Saône Séquence 7]()
Mandataire : Tim Boursier Mougenot - paysagiste Équipe : Anne Laure Giroud - paysagiste ; Alep Architectes - architecte du patrimoine ; LEA - Concepteur lumière ; Ginger - BET VRD, Hydraulique,
Ouvrage d’art; BIOTEC - Génie Végétal. Artistes : Le Gentil Garçon - Tadashi Kawamata
Déployé sur une longueur de 1,7km, le site de la promenade de Fontaines-sur-Saône tourne son regard vers l’Ile Roy, laquelle, au contraire de l’Ile Barbe, est en partie inhabitée. Les rives de
Fontaines, encore très sauvages, présentent quelques particularités. La morphologie de la rive entraîne une forte érosion des berges, deux ruisseaux et une source traversent le parcours, tandis
que se succèdent un certain nombre d’éléments insolites : une île ponton, une halte fluviale, une presqu’île. Au-dessus se déploie le centre urbain et commercial très actif de
Fontaines-sur-Saône.
Le site connaîtra une vraie renaissance, après avoir été scindé par une voie de circulation très importante – l’un des principaux accès à Lyon par le nord – et privé d’accès à la rivière.
Le projet permettra de créer une longue promenade agrémentée de larges chambres vertes où de nouvelles anses et plages de galets sont installées pour permettre de « toucher l’eau ».
Cette séquence incarne, sur moins de deux kilomètres, la double identité urbaine et végétale de Rives de Saône.
Le groupement Tim Boursier Mougenot, Anne-Laure Giroud, Alpe Architecture, LEA, Ginger et Biotec aménage une séquence très naturelle mais fragile, fortement soumise à l’érosion. Il s’agira de
donner à voir les qualités naturelles du lieu en redonnant de la continuité au cheminement piéton, au plus près de l’eau.
L’enjeu est également de valoriser les liens entre la promenade sur rives, la halte fluviale et le centre de Fontaines qui bénéficiera, lui aussi, d’un projet de renouvellement urbain, sans
oublier la voie cyclable existante. Le groupement créera selon la géographie de vastes prairies, de petites anses vertes ou des plages de galet permettant la recomposition de la faune et flore
aquatique.
Les maîtres d’œuvre travailleront également aux interfaces pratiquement inexistantes entre la rive et le quai haut en proposant notamment de requalifier une grande partie de la façade urbaine, et
notamment le large giratoire qui, une fois supprimé, laissera place à de larges gradins végétalisés. Un escalier monumental vient s’intégrer dans le mur de quai et rend accessible la halte
fluviale aujourd’hui délaissée.
« entrer dans le jeu »
![Rives de Saône Séquence 7-1]()
Entre l’île Roy et le Bourg de Fontaines-sur-Saône, la promenade cède place à de larges pelouses où il fait bon pique-niquer, jouer au ballon, lire ou se prélasser au soleil. La rivière, peu
profonde, y est ponctuée d’éléments insolites : plages naturelles, pontons, cours d’eau annexe venant s’y jeter. La vue sur l’île Roy s’avère magnifique. Dans ce site aéré et propice à la
détente, le Gentil Garçon a disséminé, comme pour un jeu de piste, une série d’interventions subtiles et oniriques. Travaillant sur l’imaginaire, Le Gentil Garçon souligne aussi le romantisme
contenu du site. Ses quatre séries d’œuvres constituent une collection de formes disséminées se fondant dans le paysage, incitant le visiteur à les rechercher et donc à parcourir le site.
Tout d’abord, Souvenir du monde inversé constituera la parfaite inversion des Girouettes à crue installées par Erik Samakh sur le site du Chemin nature. Il s’agit d’un arbre à poissons éolienne
dont les branches supportent des poissons faisant office de girouettes. L’idée de ces poissons dans l’arbre est venue à l’artiste à la pensée de la rivière en crue et de sa manière, après la
débâcle et au delà de la catastrophe, de poétiser le paysage et de l’inverser. Cet arbre en métal de près de huit mètres de haut apparaîtra comme une sorte de mobile, dont les branches porteront
des poissons qui tourneront au gré du vent.
Plus loin, La Sucrerie, une curieuse forêt de roseaux percera la surface de l’eau ; à y regarder de plus près, le promeneur s’apercevra qu’il s’agit de cheminées d’usine miniatures. Leurs
panaches forment des fleurs ou des fruits colorés. En écho aux industries qui se sont développées sur l’autre rive, elles seront comme les vestiges d’une civilisation engloutie par une crue
dévastatrice. L’artiste joue ici sur le changement d’échelle et glissement de sens en rapport avec le paysage industriel visible sur la rive opposée.
![Rives de Saône Séquence 7-2]()
Les Cercles logiques, sortes de souches métalliques, seront, eux, en tous points semblables aux troncs d’arbres qui jonchent les bords des rivières. A la différence que les cernes concentriques
de leur coupe dessineront des motifs qui ne peuvent avoir été l’œuvre de la nature, établissant ainsi de curieuses correspondances entre microcosme et macrocosme, entre nature et culture. Le
Gentil Garçon a choisi volontairement non pas les lignes de croissance de l’arbre, mais différents schémas également concentriques (système solaire, cercle chromatique, empreinte digitale,
labyrinthe médiéval...).
Enfin, La Théorie des nœuds représente des nœuds traditionnels accrochés comme des tableaux aux anneaux d’amarrage encastrés dans le mur du quai. Ces anneaux d’amarrages présentent un vaste
échantillonnage de nœuds se référant à différentes époques et cultures (inca, chinoise, celte, japonaise...) et évoquant les nœuds marins. Leur double valeur décorative et symbolique (explicitée
à chaque fois par un panneau : porte-bonheur, pérennité, union, harmonie) se conjugue en une envoûtante invitation au voyage.
Le cheminement invite également à suivre le fil rouge mené par Tadashi Kawamata, ici, La Tour belvédère, avant de redescendre le long d’une rampe adossée au mur de quai, sur un lieu plus intime
au droit de l’île ponton. Le promeneur pourra découvrir les paysages, la faune et la flore mais aussi la force de la rivière sur l’île, véritable rescapée des crues.
![Rives de Saône Séquence 7-3]()
Œuvres de Le Gentil Garçon :
« Souvenir du monde inversé »
Arbre : fonte d’aluminium brute (épaisseur 15 mm) Poissons : fonte d’inox, finition poli brillant. Fondation en béton massif. Dimensions : Arbre : 9 mètres de hauteur, 54 cm de diamètre. Poissons
: 7 poissons, 120 cm de longueur maximum, 100 kg maximum chacun.
« La théorie des nœuds »
Nœuds : fonte d’aluminium et thermo-laquage Anneaux : fonte d’acier Dimensions : Nœuds : 1,2 mètre de diamètre environ Anneaux identiques à ceux déjà présents sur le site.
« La sucrerie »
Fonte d’aluminium pleine, peinture qualité marine très haute résistance thermo-laquée. Dimensions des cheminées : Hauteur : entre 55 et 140 cm. Diamètre:5à10cmàlabase.
Nombre : 20 cheminées, avec 4 modèles différents et 5 à 6 types de volutes.
« Les cercles logiques »
Fonte d’aluminium d’épaisseur 15 mm avec incrustation d’un autre métal ou d’un matériau composite. Nombre : 7 souches disséminées sur le site. Dimensions : 50 cm de diamètre maximum, 20 à 70 cm
de hauteur.
Modalités de réalisation : Tirage en atelier avec des moules réalisés à partir de souches présente sur le site.
Œuvre de Tadashi Kawamata
« La Tour Belvédère » Structure, platelage et bardage : bois (pin douglas, chêne ou robinier) Escalier circulaire : acier galvanisé ou aluminium. Garde-corps et mains courantes : acier galvanisé
Toiture : zinc
![Rives de Saône Séquence 7-4]()
►► SÉQUENCE 8 : PROMENADE DES GUINGUETTES DE ROCHETAILLÉE- SUR-SAÔNE
![Rives de Saône Séquence 8]()
Mandataire : IN SITU - Emmanuel Jalbert – David Schulz Équipe : LEA - Concepteur lumière ; OGI - BET ouvrage d’art ; ICC - BET VRD ; SINBIO - BET Génie végétal. Artistes : Didier Fiuza Faustino,
Sabina Lang/Daniel Baumann, Le Gentil Garçon.
Sur plus de 2,2km, entre le quai Pierre-Dupont et le Quai Lamartine, dans une ample courbe de la Saône, le site de la promenade des guinguettes de Rochetaillée s’ouvre généreusement sur le vaste
paysage des Monts d’Or.
Sa disposition privilégiée, sur la rive convexe de la Saône, a favorisé la formation par la rivière d’amples et généreuses prairies dédiées aux loisirs et aux déjeuners dominicaux.
Les plages de Rochetaillée sont fréquentées dès le XIXème siècle par les Lyonnais, qui s’y rendaient grâce au tramway à vapeur autrement appelé « guillotine », puis au tramway électrique ou «
train bleu ». En 1928, une première guinguette s’y installe.
Dernièrement cependant, ce paysage s’est un peu « bouché ». Le projet Rives de Saône rouvrira le panorama sur les Monts d’Or et le château de Rochetaillée qui domine le site.
C’est ici que débute – ou se termine, au choix de chacun – le cheminement piéton de la première phase du projet Rives de Saône.
Le groupement formé par In Situ paysagistes, LEA, OGI-BET, Sinbio-BET et ICC-BET travaillera sur les 2,2 km du site pour re-créer des accroches avec le village et le vallon de Rochetaillée
(aujourd’hui séparé des bords de Saône par une route départementale à trois voies), renforcer et mettre en valeur les usages existants (restauration des guinguettes, clubs et activités sportives
et ludiques...) et diminuer l’impact de la circulation et du stationnement automobile.
Sous le signe de la douceur et de la détente, l’équipe de concepteurs décline un programme d’interventions qui invitent à profiter de ce paysage remarquable :
-La création de plages vertes et de plages de galets dans la pente douce descendant vers la Saône ;
-Le développement des activités (guinguettes, clubs nautiques, location de bateaux électriques...) ;
- L’aménagement du chemin de la plage libéré du stationnement sauvage et développement d’une large promenade en partie haute avec une voirie apaisée.
L’ensemble du projet donne à voir les paysages alentours : carrière de Couzon, mont Verdun, mont Cindre, le château de Rochetaillée ainsi que l’ensemble de la côte des Monts d’Or.
Tant le château, l’écluse, le pont suspendu de Couzon, que les grandioses carrières qui dominent le site font de ce lieu un cadre unique et spectaculaire. Réputée dans toute l’agglomération
lyonnaise, la promenade de Rochetaillée séduit aussi avec ses guinguettes et ses bords de rivière où faire la sieste. Prenant en compte cette dimension de loisir et de détente, les artistes
Lang/Baumann, Didier Fiuza Faustino et Le Gentil Garçon ont chacun imaginé des dispositifs aussi étonnants qu’inédits avec pour dénominateur commun le ludique.
![Rives de Saône Séquence 8-1]()
Les trois artistes sélectionnés pour travailler sur le site de Rochetaillée ont tous inclus la dimension paysagère remarquable dans leurs propositions en invitant les passants à changer de
perspective.
Les Suisses Sabina Lang/Daniel Baumann proposent Beautiful Steps, un escalier tournant au-dessus de la rivière et conduisant à un belvédère d’où l’on peut contempler la Saône et ses environs. En
écho au château de Rochetaillée, l’escalier en porte à faux des deux artistes ne mène nulle part, sauf à la contemplation. Les artistes invitent les promeneurs à emprunter cet escalier pour
s’élever aux bords de la Saône et adopter un autre point de vue sur leur environnement. Ils offrent aussi aux flâneurs une image insolite à regarder, même pour ceux qui feraient le choix de ne
pas gravir les marches.
Au creux de la prairie, le Gentil Garçon propose une œuvre en forme de cratère, formé par une météorite qui se serait écrasée ici. Ses pentes moelleuses deviennent toboggan et mur d’escalade. Les
plus jeunes pourront s’insinuer sans danger dans les alvéoles lumineuses de ce Génialithe. Objet à escalader en lui-même, la météorite garnie de lentilles réfléchissante fait apparaître prismes
et jeux de lumière et offre des espaces à explorer.
L’eau est aussi un miroir. C’est là-dessus que joue Didier Fiuza Faustino, qui invite à s’élever, à prendre de la hauteur au-dessus de la rivière. Ses Trompe le Monde, « postes d’observation » en
inox poli miroir reflète le paysage, diluant alors le corps dans son environnement tout en créant une distorsion optique à l’horizon des promeneurs du site de Rochetaillée. L’œuvre propose ainsi
une double expérience de l’ordre de l’intime et du collectif, s’inscrivant dans une problématique au cœur du travail de Didier Faustino.
Autre œuvre présente sur cette séquence, et inscrite dans le fil rouge de Tadashi Kawamata, le projet La cabane, fait écho aux formes d'habitations vernaculaires les plus basiques (huttes,
baraques, cabanons) et à une certaine mythologie qui continue à alimenter l'imaginaire collectif. Cette mythologie a toute sa place dans le site très champêtre et arboré de Rochetaillée, où
l'œuvre saura « parler » à tous les publics, notamment les familles.
![Rives de Saône Séquence 8-2]()
Œuvre de Didier Fiuza Faustino
« Trompe le Monde »
Inox poli miroir sur la face avant des panneaux. Acier galvanisé pour l’arrière des panneaux, les échelles et les finitions. Poteau en béton brut. Panneaux emboutis : 4m x 3m environ. Hauteur du
poteau en béton : 2,5 m.
Œuvre de Lang & Baumann
« Beautiful Steps »
Béton technologique. 8,9 x 5,5 x 3,2 mètres - Envergure du porte à faux : entre 7 et 8 mètres. Capacité d’accueil : 20 à 30 personnes maximum.
Œuvre de Le Gentil Garçon
« Génialithe »
Météorite : béton et pavés de verre incrustés - 2,75 mètres de hauteur / 2,5 tonnes. Cratère : 14 mètres pour le diamètre supérieur et 7,7 mètres en fond de cratère.
- zones de glisse : béton projeté lissé et résine facilitant la glisse.
- zones de grimpe : béton projeté non lissé et résine de protection.
Une structure métallique permet de réaliser la forme des toboggans (de 70 cm à 901 cm de largeur). Sol du cratère : granulats de caoutchouc liés avec des résines polyuréthanes.
Œuvre de Tadashi Kawamata
« La Cabane »
Ensemble bois (poutres de 15 x 15 cm). Volume : 12 à 15 m3 environ. Les dimensions précises seront à déterminer sur le site pendant la construction.
![Rives de Saône Séquence 8-3]()
 L’équipe Kengo Kuma et CRB architectes associés à Bouygues Immobilier SLC pour l’îlot P-Place Nautique de Lyon Confluence
L’équipe Kengo Kuma et CRB architectes associés à Bouygues Immobilier SLC pour l’îlot P-Place Nautique de Lyon Confluence


 Phase II pour Lyon Confluence …
Phase II pour Lyon Confluence …






 Un HUB destiné à l’Information à
Un HUB destiné à l’Information à 

 Lyon : la Rue Garibaldi s’apprête à requalifier son tronçon, vers une ‘’coulée
verte’’
Lyon : la Rue Garibaldi s’apprête à requalifier son tronçon, vers une ‘’coulée
verte’’



 L’ouverture ce 04 avril du Pôle de loisirs et de commerces à Lyon Confluence
L’ouverture ce 04 avril du Pôle de loisirs et de commerces à Lyon Confluence


 La région
Rhône-Alpes retient 5 équipes pour la reconversion du Site de Charbonnières
La région
Rhône-Alpes retient 5 équipes pour la reconversion du Site de Charbonnières
 8 séquences pour un
river-movie sur les rives de Saône
8 séquences pour un
river-movie sur les rives de Saône



























 Le Monolithe, entre mixité et sociale et architecturale… Lyon
Confluence…
Le Monolithe, entre mixité et sociale et architecturale… Lyon
Confluence…




 @ ECDM
@ ECDM

 L’Îlot A3 de Lyon Confluence 2 attribué à
Icade associé à Herzog & de Meuron
L’Îlot A3 de Lyon Confluence 2 attribué à
Icade associé à Herzog & de Meuron





 La Ville intelligente pour le Grand Lyon, 3 défis : initier, fédérer et dynamiser
La Ville intelligente pour le Grand Lyon, 3 défis : initier, fédérer et dynamiser
 Le démonstrateur Lyon Smart Community prend vie sur le quartier de Lyon Confluence
Le démonstrateur Lyon Smart Community prend vie sur le quartier de Lyon Confluence
 © Kuma
© Kuma
 © Kuma
© Kuma
 © Kuma
© Kuma